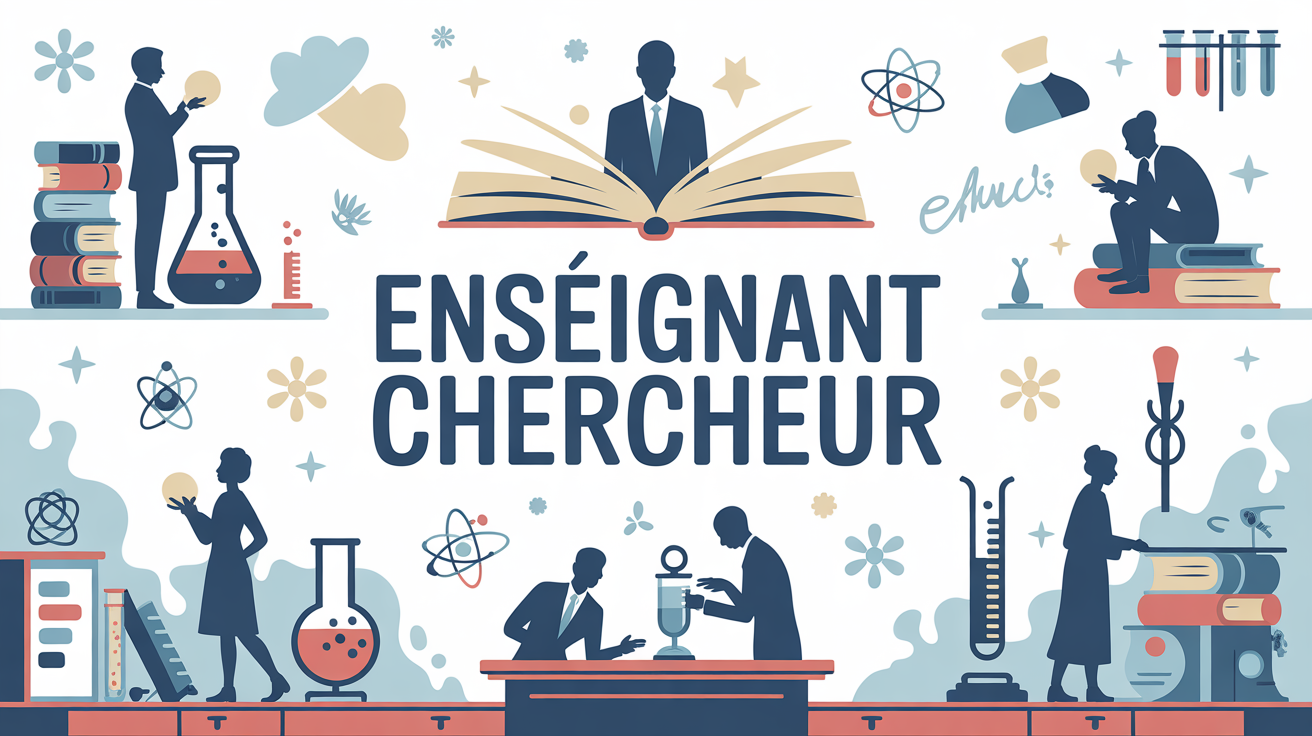Se lancer dans le métier d’enseignant-chercheur en France, c’est véritablement un projet d’envergure ou parcours universitaire rime avec persévérance : doctorat longue durée, concours particulièrement exigeants, financement de thèse à prévoir et équilibre délicat entre enseignement, recherche et gestion administrative. En y allant avec quelques stratégies efficaces et une bonne dose de motivation, cette voie offre une vraie liberté intellectuelle, une variété stimulante de missions, et un terrain de jeu idéal pour quiconque a soif d’apprentissage, tout en aimant partager ce qu’il découvre… sans forcément manier le jargon le plus pointu. Une formatrice partageait récemment qu’elle n’avait jamais regretté ce choix pour cette raison !
Comment devient-on enseignant-chercheur en France ? (La réponse directe)
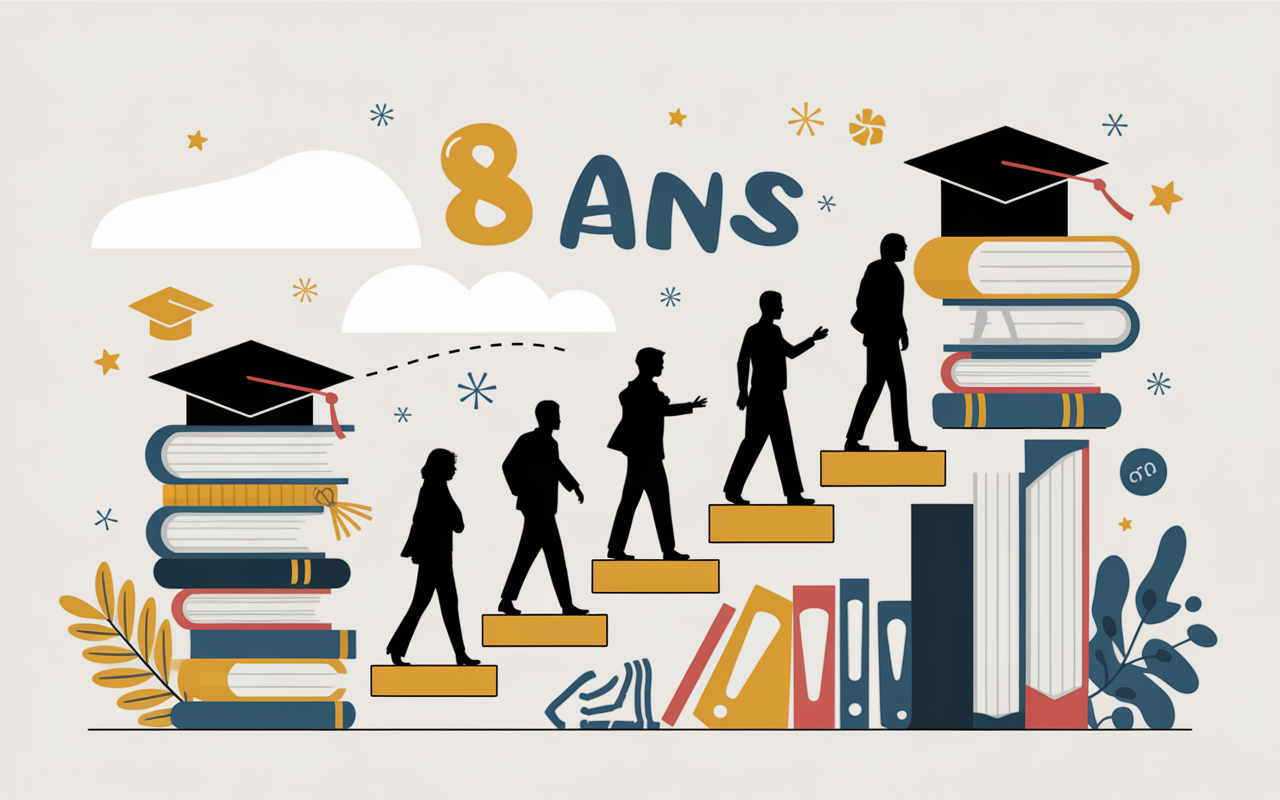
Le parcours pour accéder au métier d’enseignant-chercheur s’apparente à un marathon mêlant passion de la recherche et plaisir de transmettre à l’université. La trajectoire à suivre est la suivante – décrocher d’abord un doctorat (bac+8), obtenir ensuite la qualification CNU, puis réussir le concours de maître de conférences. Pour viser le professorat, l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) est indispensable. On note que ce chemin est exigeant, mais avec méthode et anticipation, il demeure accessible pour bien des profils. Certains professionnels conseillent d’anticiper chaque étape, et de s’accorder des phases de respiration pendant le cheminement.
À garder à l’esprit : il faut compter 8 années d’études après le bac, sécuriser le financement de la thèse (bourse, contrat doctoral…), affronter des concours relativement sélectifs (en moyenne 54 % de réussite à la qualification CNU), et envisager un début de carrière entre 2 091 et 3 100 € brut/mois en tant que maître de conférences (Orientation Centre-Val de Loire ; GMF ; IMT). Certains témoignages signalent que la patience et un bon réseau font régulièrement la différence.
Qu’est-ce qu’un enseignant-chercheur ?
Probablement, vous avez déjà croisé un enseignant-chercheur dans les couloirs de la fac ou lors d’un colloque sans trop savoir comment se répartissaient ses journées. Ce métier multiplie les rôles et jongle entre l’amphi, le laboratoire et l’administratif, parfois sur des horaires extensibles. Il arrive d’ailleurs à certains de finir des corrections tard dans la nuit.
Missions principales au quotidien
Au quotidien, l’enseignant-chercheur oscille entre l’enseignement (cours, TD, TP en université ou école) et la recherche scientifique, tout en accompagnant mémoires ou thèses et en publiant des articles. La participation à des colloques, l’encadrement des étudiants, et l’entretien de la dynamique d’équipe font également partie du lot. Concrètement, une formatrice soulignait que “chaque semaine est différente, selon les échéances des étudiants, la charge de recherche ou les projets de labo”.
Côté chiffres forts : 1607 heures par an en moyenne, dont une part dédiée à la recherche, variant selon les institutions et la discipline suivie. On constate que le rythme peut s’intensifier en période de soutenances ou de rentrée.
Compétences et état d’esprit
Inutile de viser la perfection, mais il vaut mieux avoir une solide dose de rigueur scientifique, une vraie fibre pédagogique, une capacité à gerer la paperasse administrative, ainsi qu’une curiosité permanente. On compare parfois ce profil à celui d’un sportif de fond passionné d’énigmes, avec des copies à corriger en bonus : sérieux, mais ludique.
- Transmettre avec clarté, simplifier même les notions complexes
- Arriver à organiser son planning pour alterner efficacement entre projets divers
- Entretenir un esprit d’équipe, que ce soit pour les projets de labo ou l’encadrement pédagogique
- Faire preuve d’autonomie et saisir les opportunités dès qu’elles se présentent
Ainsi, la pluralité des domaines permet à chacun de tracer son propre parcours, du mathématicien puriste à l’historien de l’art. Il n’est pas rare d’entendre un enseignant-chercheur dire qu’il a changé d’axe disciplinaire au fil des années. Est-ce une rigidité ou une liberté ? C’est une question que certains se posent après quelques années…
Étapes du parcours universitaire : diplômes, concours et qualification
On ne se ment pas – l’itinéraire est balisé, mais on trouve parfois, des détours selon le domaine ou des opportunités inattendues. Voici le plan, étape par étape, selon les grandes lignes du système universitaire.
Les diplômes indispensables (la base du game)
Le socle attendu rassemble généralement :
- Un diplôme de Licence (bac+3)
- Puis un Master (bac+5)
- Enfin, un Doctorat, indispensable dans chaque discipline (hors cas très rares)
En général, la durée du doctorat varie de 3 à 4 ans, mais pour certains doctorants, elle s’étend jusqu’à 6 ans selon la nature du projet. On remarque que la validation de la thèse demeure le passage obligé avant toute suite de carrière.
La qualification CNU : le sésame avant le concours
La fameuse “qualification CNU” ouvre la porte aux concours de maître de conférences partout en France. Il s’agit d’une étape quasi-incontournable attribuée par des pairs qui évaluent publications, expériences et engagement scientifique. Un chiffre qui interpelle : à peine 54 % des candidats obtiennent cette qualification, d’où l’importance d’une préparation minutieuse (un membre de jury confiait récemment que les publications représentaient la matrice de décision !).
Passée la qualification, vous accédez ensuite aux concours spécifiques de chaque établissement. Cela implique un solide dossier d’enseignement et de recherche mais aussi une audition exigeante, du type “soutenance sous tension”.
| Étape | Durée (en années) |
|---|---|
| Bachelor (licence) | 3 |
| Master | 2 |
| Doctorat | 3-4 |
| Qualification CNU + concours | 1-2 |
En pratique, l’âge à l’entrée tourne autour de la trentaine pour un maître de conférences et de la quarantaine pour un professeur confirmé. Parfois, un doctorant partage qu’il n’avait pas anticipé la transition si longue !
Financer sa thèse et être accompagné : les tuyaux à connaître
Le doctorat allie passion et préoccupations très concrètes. La question du financement revient sans cesse: ou trouver les aides, comment constituer un “filet de sécurité” pour ne pas finir dans l’impasse financière avant la soutenance ?
Panorama des solutions pour s’en sortir financièrement
Pour le financement, plusieurs pistes s’offrent aux doctorants :
- Démarcher une bourse ou un contrat doctoral reconnu
- Explorer les contrats CIFRE (effectuer sa thèse en entreprise, souvent mieux rémunéré… mais exigeant en organisation quotidienne !)
- Se rapprocher des bourses au mérite ou spécifiques selon la discipline
- Opter pour des emplois d’ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche) durant le doctorat
En réalité, un contrat doctoral standard rapporte environ 2 043 € brut/mois. L’ATER oscille entre 1 800 et 2 100 € brut/mois, généralement sous forme de mi-temps afin de permettre la continuité de la thèse. Il n’est d’ailleurs pas rare que des doctorants partagent leurs petites stratégies pour arrondir leurs fins de mois.
L’accompagnement par l’école doctorale
L’école doctorale joue souvent le rôle de tour de contrôle : elle valide votre sujet de recherche, propose des formations méthodologiques ou linguistiques, aide à trouver des financements et reste interlocuteur clé pour toute la durée du doctorat. N’hésitez pas à solliciter ce relais pour comprendre les dispositifs d’accompagnement ou participer à des ateliers thématiques : certains y trouvent de vrais leviers inattendus, selon des retours d’expériences recueillis lors de réunions de rentrée.
Une interrogation fréquente revient : “Se lancer sans financement, est-ce raisonnable ?” Il paraît hasardeux d’y aller sans au moins une allocation sécurisée. Rien n’exclut que cette précaution épargne beaucoup de stress en cours de route, à en croire les témoignages des chercheurs confirmés sur ce point.
Processus de sélection, qualification CNU, concours et mobilité
Une fois la thèse achevée, la suite se durcit : la qualification CNU, les concours, et la mobilité souvent nécessaires entrent en scène. Loin de l’image glamour, ces étapes peuvent surprendre, mais elles restent incontournables.
Qualification CNU et ses secrets
Le Conseil National des Universités (CNU) octroie la qualification après avoir étudié avec attention dossier scientifique, pédagogique et publications. Deux facteurs pèsent particulièrement lourd : la qualité de la thèse soutenue et le nombre de publications (articles, conférences, chapitres…). Selon une enseignante, l’entretien de bonnes relations avec son encadrement et ses pairs lors de la rédaction de la thèse peut vraiment jouer en faveur de la candidature.
Sur 12 000 candidats, seuls 54 % décrocheraient cette qualification chaque année. Pour renforcer ce taux, publier dès le doctorat s’avère une démarche judicieuse et très payante (plusieurs jeunes maîtres de conférences partagent cet avis lors de forums universitaires).
Concours, mobilité et passerelles
Une fois qualifié, chaque candidat s’attelle à la recherche d’un poste de maître de conférences, concours organisé par chaque établissement. Dossier, audition, parfois exposé ou mini-cours : la compétition est sévère, et il arrive que certains déposent une dizaine de dossiers ou plus avant d’obtenir leur premier poste !
- Accumuler de l’expérience en tant qu’ATER apparaît souvent comme le tremplin idéal pour étoffer son CV
- S’attendre à une mobilité nationale quasi-obligatoire en début de carrière (il arrive qu’un poste vous conduise loin de votre université d’origine)
- Certains enseignants du secondaire ou candidats en reconversion peuvent faire valoir des acquis, cependant il vaut mieux prévoir de repasser par un doctorat ou la qualification CNU
Micro-anecdote entendue lors d’un entretien : “Après trente candidatures et une quinzaine d’auditions, j’ai décroché mon premier poste…” Comme quoi, la persévérance finit souvent par payer, même si le parcours n’est pas de tout repos.
Carrière, salaires et évolutions : ce qu’il vaut la peine de savoir avant de foncer
Pour la rémunération, tout est affiché noir sur blanc : le statut public implique des grilles salariales fixes, mais l’évolution tient compte du concours, de l’ancienneté et, parfois, d’opportunités d’affectation. Une spécialiste de la fonction publique notait récemment que la mobilité dans les premières années accélère aussi la progression de carrière.
Les chiffres clés du métier en un coup d’œil
| Statut | Salaire brut mensuel | Âge moyen d’accès |
|---|---|---|
| Maître de conférences débutant | 2 091 à 3 100 € | Début trentaine |
| Maître de conférences confirmé | Jusqu’à 5 000 € | |
| Professeur des universités | 3 000 € à 6 200 € | Quarantaine |
La marge de progression est significative avec l’expérience (l’HDR demeure la clé pour accéder aux fonctions de professeur des universités). Ce parcours garantit une stabilité liée à la fonction publique, un vrai espace d’innovation, mais aussi une concurrence marquée et une charge de travail qui tend à devenir conséquente. Selon certains, le maintien d’un équilibre entre vie personnelle et professionnelle s’anticipe dès le départ.
- Apprécier la liberté académique et pouvoir s’ouvrir à la direction de laboratoire, voire à l’international
- Composer avec la concurrence, la mobilité, et s’assurer de préserver son équilibre de vie hors travail
Dernier écho du terrain : un collègue demandait récemment s’il recommencerait ce parcours la réponse restait positive, à condition de garder la passion et d’aborder la suite avec préparation et lucidité.
Outils et ressources pratiques utiles pour réussir son parcours
Il vaut mieux éviter de s’isoler face à la complexité administrative ou aux acronymes techniques : de nombreux outils gratuits existent pour s’orienter, simuler sa progression et capitaliser sur des conseils de pairs. Certaines associations étudiantes diffusent parfois même des “kits de survie” pour les nouveaux doctorants.
Guides, simulateurs et accompagnement
- Utiliser un simulateur de salaire enseignant-chercheur (proposé gratuitement par GMF, IMT entre autres)
- Consulter les annuaires d’écoles doctorales ou des catalogues de formations selon sa spécialité
- Participer à des webinaires ou ateliers FAQ, habituellement hébergés par l’université d’inscription
- Tirer parti de guides pratiques comme le Livret Enseignant-Chercheur IMT
- Découvrir les témoignages de parcours atypiques et écouter les retours d’expériences
Avant de candidater, pensez à parcourir un simulateur de carrière : sans prétendre à la prédiction, il permet néanmoins d’avoir une vision plus claire de ses futures conditions de travail et d’évolution. Une professionnelle en accompagnement universitaire insistait sur l’intérêt de ces outils pour éviter des déconvenues.
FAQ express
- Combien d’années d’études après le bac ? Prenez en compte au moins 8 ans, auxquels s’ajoutent parfois des années supplémentaires pour se préparer à la qualification ou au concours.
- Est-il possible de financer sa thèse sans bourse ? En pratique, c’est rarement viable, d’où l’importance de solliciter tous les dispositifs d’aide existants.
- Des reconversions existent-elles ? Oui, elles sont envisageables, mais il faut se renseigner minutieusement : il est souvent nécessaire de reprendre un doctorat puis l’ensemble du parcours CNU.
Dernier point à garder à l’esprit : ne sous-estimez jamais la force du réseau (journées doctorales, associations, colloques). Bon nombre d’enseignants-chercheurs rapportent que le déclic de leur premier recrutement est venu justement d’une rencontre lors d’un événement collectif.